FONCTIONNEMENT
Le TD de communication du S4 vise à développer les qualités orales de communication, de réflexion et de positionnement des étudiant.es sans les limiter à des exposés ex-cathedra stériles devant une série de slides inutiles.
- La présence des étudiant.e.s est obligatoire, l’évaluation étant impossible sans assiduité ou partielle sans continuité.
- Les thématiques proposées peuvent être amendées à l’avance (une semaine) et d’autres devront être proposées par le groupe classe. Cette page est donc en construction (02 janvier 2023)
- Chaque TD se divise en trois parties : une ressource thématique de départ ; des échanges collectifs ; un moment de synthèse/bilan écrit + une fiche d’évaluation individuelle du TD.
CONTENU
A partir de thématiques organisationnelles, politiques, culturelles et sociales, nous interrogerons les points suivants. Chacun.e pourra par ailleurs interroger sa manière de participer au groupe.
- Comment se déroulent les différents échanges dans le groupe de TD ?
- Comment abordons-nous les thèmes proposés ?
- Comment circule la parole entre les personnes ?
- Comment chaque personne participe-t-elle aux échanges ?
- À quoi l’écoute engage-t-elle ?
THÈMES
1. Et Demain ?
Comment voyez-vous le monde de demain ? Le vôtre ? Le nôtre ?
Cette question porte à la fois sur la dimension écologique, au sens large de l’organisation des équilibres du vivant (GIEC 2022), et sur vos aspirations personnelles.
Quels exemples de vie écologique existent déjà ?
Cyril Dion et Mélanie Laurent, Demain (2015)
Que veulent les jeunes Européen.nes ?
RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES – # 1
« Perturber un événement sportif pourrait être durement réprimé »
« Pistes de ski et lac artificiel : l’Arabie saoudite organisera des Jeux asiatiques d’hiver »
2. Discriminations
De quoi s’agit-il ? Que dit la loi ? Avez-vous été l’objet de discriminations ? Avez-vous été témoins de discriminations ?
SOURCE. Plateforme anti-discrimination | https://www.antidiscriminations.fr
- Vous êtes-vous déjà senti objet de discrimination ? Victime ?
- Quelles ont été vos pensées ? émotions ? Actions ?
- Quelles sont les raisons/ressorts de la discrimination ?
- D’une manière plus générale, avez l’impression de vivre dans une société discriminatoire ? Sur quoi se fondent vos impressions ? votre savoir ?

3. Violé.es : Une histoire de domination
LSD | France Culture | 7 décembre 2020
Témoignage de MATHILDE FORGET, Auteure, compositrice, interprète.
Première séquence (0-17 mn) : En venir aux mots.
Deuxième séquence : (27’34 » – 52 mn ) : S’en sortir seules par la colère ?
Musique de fin : « Baisers volés » d’Oxytocine (Julia Maura)
Virginie Despentes, King Kong théorie
Celles à qui ça arrive, du point de vue des agresseurs, d’une manière ou d’une autre ils s’arrangent pour le croire, tant qu’elles s’en sortent vivantes, c’est que ça ne leur déplaisait pas tant que ça. C’est la seule explication que j’ai trouvée : dès la publication de Baise-moi, je rencontre des femmes qui viennent me raconter « j’ai été violée, à tel âge, dans telles circonstances ». Ça se répétait au point d’en être dérangeant, et dans un premier temps, je me suis même demandé si elles mentaient. C’est dans notre culture, dès la Bible et l’histoire de Joseph en Égypte, la parole de la femme qui accuse l’homme de viol est d’abord une parole qu’on met en doute. Puis j’ai fini par admettre : ça arrive tout le temps. Voilà un acte fédérateur, qui connecte toutes les classes, sociales, d’âges, de beauté et même de caractère. Alors, comment expliquer qu’on n’entend presque jamais la partie adverse : « J’ai violé Unetelle, tel jour, dans telles circonstances » ? Parce que les hommes continuent de faire ce que les femmes ont appris à faire pendant des siècles : appeler ça autrement, broder, s’arranger, surtout ne pas utiliser le mot pour décrire ce qu’ils ont fait. Ils ont « un peu forcé » une fille, ils ont « un peu déconné », elle était « trop bourrée » ou bien c’était une nymphomane qui faisait semblant de ne pas vouloir : mais si ça a pu se faire, c’est qu’au fond elle était consentante. Qu’il y ait besoin de la frapper, de la menacer, de s’y prendre à plusieurs pour la contraindre et qu’elle chiale avant pendant et après n’y change rien : dans la plupart des cas, le violeur s’arrange avec sa conscience, il n’y a pas eu de viol, juste une salope qui ne s’assume pas et qu’il a suffi de savoir convaincre.
(…)
 C’est étonnant qu’en 2006, alors que tant de monde se promène avec de minuscules ordinateurs cellulaires en poche, appareils photo, téléphones, répertoires, musique, il n’existe pas le moindre objet qu’on puisse se glisser dans la chatte quand on sort faire un tour dehors, et qui déchiquetterait la queue du premier connard qui s’y glisse. Peut-être que rendre le sexe féminin inaccessible par la force n’est pas souhaitable. Il faut que ça reste ouvert, et craintif, une femme. Sinon, qu’est-ce qui définirait la masculinité ?
C’est étonnant qu’en 2006, alors que tant de monde se promène avec de minuscules ordinateurs cellulaires en poche, appareils photo, téléphones, répertoires, musique, il n’existe pas le moindre objet qu’on puisse se glisser dans la chatte quand on sort faire un tour dehors, et qui déchiquetterait la queue du premier connard qui s’y glisse. Peut-être que rendre le sexe féminin inaccessible par la force n’est pas souhaitable. Il faut que ça reste ouvert, et craintif, une femme. Sinon, qu’est-ce qui définirait la masculinité ?
(King Kong théorie, Le livre de poche, pp. 35 et 48).
Julie Abbou, Tenir sa langue
Agir sur le langage pour agir sur le monde. Voilà le programme des mouvements sociaux qui s’engagent dans la lutte des significations. Le féminisme a de longue date pris à bras-le-corps cette question de la langue, et pour cause : le langue est un lieu de notre catégorisation du monde. Il s’agit de contester la mainmise du masculin sur l’humanité. Il s’agit de pouvoir s’énoncer, de participer au sens du monde à part pleine et entière. C’est dans cette urgence politique et sémantique à pouvoir exister en tant que sujet humain, et à donner un autre sens à l’humanité, que les féministes se sont mises à bousculer la grammaire.
Pour saisir toute la force et tous les enjeux d’un tel geste, il faut d’abord débusquer la puissance du genre grammatical et son histoire politique : on se balade au milieu des grammairiens et de leurs règles pour s’apercevoir qu’en matière de langue rien ne va de soi et que ça peut même venir de quelque part ; que le masculin l’emporte sur le féminin, cela ne s’est pas fait par hasard.
(…)
L’arnaque se reproduit régulièrement. Parmi les coups les plus connus, on cite souvent celui de Vaugelas, qui écrit en 1647 que « le masculin est le genre le plus noble », mais il n’est pas seul à défendre cette idée : l’abbé Bouhours ajoute en 1675 que « Lorsque les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l’emporte ». Nicolas Beauzée abonde un siècle plus tard, au cas où l’on n’aurait pas bien compris : « Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle ».
(…)
Plus proche de nous dans le temps, mais proche de Protogoras dans l’esprit, des grammairiens des années 1930 développent l’idée que des mots féminins exprimeraient la substance féminine de ce qu’ils désignent : « La mer est d’aspect changeant comme une femme, journalière, d’humeur mobile comme une jolie capricieuse, attirante et dangereuse comme une beauté perfide.» [in, Jean Damourette et Édouard Pichon, Essai de grammaire de la langue française, Éditions d’Artrey, 1930]
(…)
Le 23 mars 2021 est déposé une autre proposition de loi, plus dure pusiqu’elle vise « à interdire et à pénaliser l’usage de l’écriture inclusive dans les administrations publiques et les organismes en charge d’un service public ou bénéficiant de subventions publiques.» La menace de pénalisation concerne particulièrement les enseignant.es du primaire, du secondaire et du supérieur. Et par « écriture inclusive » sont visées « les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine». Oui, vous avez bine lu : le problème serait de faire ressortir l’existence d’une forme féminine en lieu et place du masculin générique. Le problème serait que le générique ne soit pas uniquement et systématiquement masculin.
(…)
Il faut assumer le fait que cette discussion est politique avant d’être technique. Il y a urgence politique à pouvoir prendre la parole, à pouvoir s’énoncer en tant que sujet à part entière et à sortir de l’ordre du genre qui nous assigne des champs des possibles distincts, selon qu’on soit homme ou pas.
Julie ABBOU, Tenir sa langue, Les Pérégrines, Collection Genres !, 2022, p. 9 ; 24-25 ; 67 ; 78
Liens complémentaires # 3
4. Culture : plein les yeux, plein les oreilles
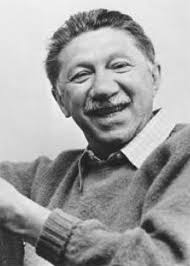 « Education can no longer be considered essentially or only a learning process; it is now a character training, a person-training process. Of course this is not altogether true, but it is largely true (…).
« Education can no longer be considered essentially or only a learning process; it is now a character training, a person-training process. Of course this is not altogether true, but it is largely true (…).
It means that we need people who are different from the average kind of person who confronts the present as if it were a repetition of the past, and who uses the present simply as a period in which he prepares for the future threats and dangers (…).
We must become more interested in the creative process, the creative attitude, the creative person, rather than in the creative product alone (…). We must focus our attention on improvising, on flexible and adaptable, efficient confronting of any here-now situation which turns up (…). »
A. H. MASLOW, The Farther Reaches of Human Nature (1971), Penguin Compass, pp. 95-96.
De quoi nourrissez-vous votre tête ? Votre esprit ? Votre cœur ?
Qu’exposez-vous à votre regard ? À vos oreilles ? À votre intelligence ? À votre sensibilité ?
L’art a-t-il un sens pour vous ?
Quels domaines de la création humaine vous préoccupent ?
5. Les bêtes et nous, comment vivre ensemble ?
ANIMAUX D’ÉLEVAGE
Compassion in World Farming International (CIWF) 2015
Déclaration universelle des droits de l'animal
La Déclaration universelle des droits de l’animal, corédigée par la LFDA, a été proclamée solennellement à Paris le 15 octobre 1978, à la Maison de l’Unesco. Son texte révisé par la Ligue internationale des droits de l’animal en 1989 a été rendu public en 1990.
Lien : la Déclaration mise à jour en 2018.
Questions
Quel article de cette déclaration vous semble le plus sensé ? Le plus juste ?
Quel article vous semble problématique, d’une manière ou d’une autre ?
Quelles sont vos relations aux animaux sauvages, d’élevage, domestiques ?
Avez-vous déjà assisté ou participé à l’abattage d’un animal d’élevage ?
Histoire du droit des animaux
https://www.actu-juridique.fr/administratif/environnement/les-animaux-ont-ils-des-droits/
ARTICLE
Grippe aviaire : 16 millions de volailles abattues en France depuis novembre, un triste record
Avec AFP. Modifié le Publié le
La deuxième vague de grippe aviaire touche actuellement à sa fin : 16 millions de volailles ont été abattues en France depuis le mois de novembre 2021. Le ministère de l’Agriculture a toutefois indiqué que l’épizootie était en train de décroître en France, ce lundi 2 mai 2022. L’an dernier, 3,5 millions d’animaux avaient été abattus, essentiellement dans le sud-ouest du pays.
ÉVALUATION
La dernière séance
L’Évaluation porte sur l’assiduité (pas sur la participation en classe), l’engagement dans la rédaction du bilan individuel, votre regard subjectif.
+ Proposition d’une note à discuter avec l’enseignant, éventuellement les pairs.
Rédaction d’un bilan individuel qui montre votre positionnement dans le groupe-classe, à partir de la trame suivante :
- Votre assiduité
- Les thèmes abordés
- Votre participation et positionnement dans le groupe
- Votre degré de confiance dans le groupe
- Les freins et les incitations à votre prise de parole
- Vos attentes vis-vis de cet espace de communication
- Votre perception du groupe-classe
- La position de l’enseignant dans le groupe
- Un moment que vous avez apprécié (pourquoi)
- Un moment que vous avez détesté (pourquoi)
- Vos remarques et commentaires
- Vos suggestions de contenu pour le prochain TP (demi-groupe)
Vous pouvez naturellement aborder d’autres aspects sur ce TD.
BILAN
- Bilan individuel (enregistré ou non) en groupe de 3 ou 4
- Bilan / évaluation du TD



