« Le sens d’une image vient de sa mise en scène »
Entretien avec Christian Caujolle
Contexte : Hocine Zaourar est l’auteur de la « madone » de Bentalha. La photographie, prise en 1997 après un massacre organisé par le GIA, a été publiée par plus de 750 journaux. Zaourar est aujourd’hui interdit de travail par le régime algérien qui l’accuse de donner une image négative de son pays ; il est par ailleurs en conflit avec l’AFP, son employeur, qui exploite la photo mais refuse de lui accorder une augmentation de salaire, alors qu’il a obtenu pour cette photo le premier prix du World Press. L’AFP est l’un des leaders sur le marché de la photographie mais doit encore se développer dans les domaines du multimédia et de la vidéo. Elle emploie 2300 salariées et fait 260 millions de chiffre d’affaires.
Christian Caujolle est directeur de la galerie et de l’agence Vu à Paris. Il a organisé à Amsterdam entre octobre et décembre 2005 une exposition, « Things As They Are – Photojournalism in context since 1955 », pour célébrer le cinquantième anniversaire du World Press.
Pourquoi exposer surtout des publications ?
Il n’y a rien de plus faux que l’expression : « J’ai vu une photo dans le journal. » La presse ne montre pas des images, elle donne une proposition de lecture. Le sens d’une image vient de sa mise en scène, du texte, de la maquette. En 1969, le magazine Life a publié les portraits des soldats morts en une semaine au Vietnam. Ces images n’ont aucune valeur, ce sont des Photomatons. Leur force vient de la façon dont elles sont présentées. L’exposition se concentre sur les magazines de l’époque.
L’exposition laisse-t-elle apparaître une « crise » du photojournalisme ces dernières années ?
Elle donne une vision fausse, car elle montre le meilleur de la production (…). La majorité des photos publiées actuellement sont médiocres. Mais, ce qui est en cause, ce n’est pas le photojournalisme, c’est la presse.
Pourquoi ?
Depuis l’arrivée de la télévision, la presse n’a plus de politique de l’image cohérente. Tantôt la photo sert de décoration, tantôt elle sert à faire du sensationnel. Les magazines, qui étaient le support de l’excellence, imitent désormais la télévision. Or, dans la course à la vitesse, ils sont perdants. En France, il n’y a guère que Match qui ait encore une ligne claire, qu’on l’apprécie ou non.
L’arrivée des phots amateurs a-t-elle changé la donne ?
C’est une évolution technique : aujourd’hui, tout le monde peut faire des photos grâce à son téléphone portable et les diffuser sur Internet. Mais ce n’est pas de la photo ! ce sont des documents. Ensuite, on a toujours besoin de vrais photographes. Lors du tsunamis, Paris Match a fait un numéro avec des photos d’amateurs, puis il est passé aux photos en noir et blanc de Philip Blenkinsop. Ce sont celles-ci qui restent.
Pourquoi des photos comme La Madone d’Hocine Zaourar deviennent-elles des icônes ?
Difficile à dire. Hocine a fait de meilleures photos que celle-ci, qui est devenue célèbre sans doute parce que c’était Bentalha, lieu symbolique des massacres, et que l’Occident a projeté sur l’image une lecture chrétienne. La baptiser La Madone est une aberration.
C’est un cas intéressant : le photographe a envoyé son négatif à l’AFP qui l’a recadré afin qu’il soit plus spectaculaire. Puis la photo est devenue un logo pour l’AFP. On pourrait faire une exposition entière consacrées à cette image et à son utilisation : dans les publications, dans la sculpture qu’en a faite Pascal Convert… Il faut ajouter la photo du journaliste d’El Watan, qui a pris la scène sous un autre angle et qui a permis de dédouaner Hocine Zaourar quand on l’a accusé, en Algérie, d’avoir fait un montage.
Propos recueillis par Claire Guillot, Le Monde, vendredi 7 octobre 2005
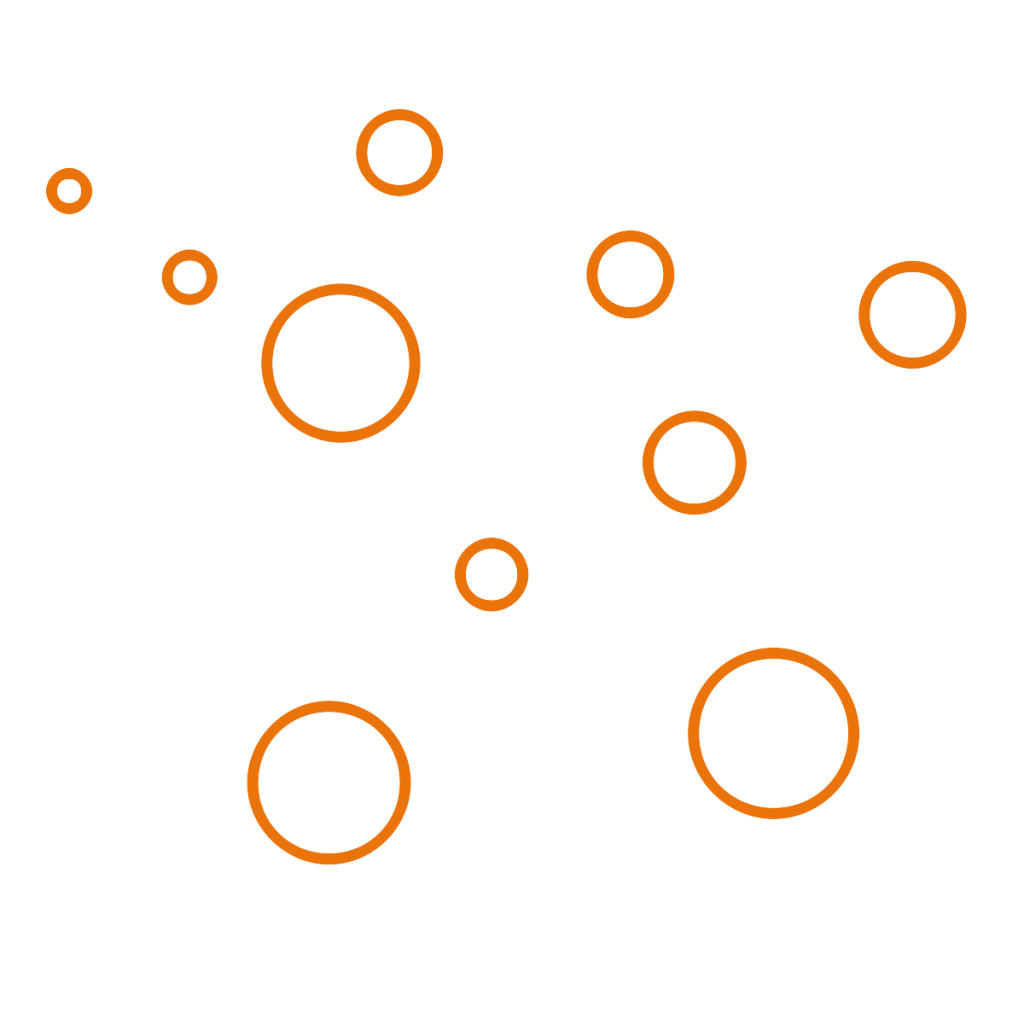
« Grandeur et décadence du photojournalisme : Tant de clichés et si peu d’images… »
EDGAR ROSKIS. Journaliste. Maître de conférences associé au département d’information communication de l’université Paris-X (Nanterre).
Par un curieux paradoxe, le photojournalisme n’a jamais été autant
célébré, et cependant ses qualités n’ont jamais paru si médiocres. Comment
s’explique un tel phénomène de dégradation et d’usure ? Comment est-on
passé d’une sorte d’âge d’or de la photographie de presse dans les années 1960
et 1970 aux images clonées, répétitives et banales d’aujourd’hui ? C’est
que regarder, voir, photographier supposent aussi une morale, une conscience et
une exigence politiques. Et que celles-ci, au cours des deux dernières
décennies libérales, se sont tout simplement effondrées.
À la fin des années 1960 et au début des années 1970, seulement quelques dizaines de photoreporters travaillant au sein des agences Gamma, Magnum, UPI et Associated Press, ou de grands magazines comme Life et Paris Match, étaient chargés de rapporter les images de l’actualité mondiale (1). Cette époque est souvent décrite comme un âge d’or. Un petit groupe d’opérateurs prestigieux et omniprésents, sous condition que chacun se trouvât au bon endroit au bon moment (« the right man, at the right time, at the right place »), aurait eu le pouvoir d’influer sur le cours de l’histoire par la seule diffusion de photographies – encore gravées dans nos mémoires – dont la force et la perfection résultaient de la mise en oeuvre de deux règles quasi scientifiques définissant un idéal spatiotemporel : l’« instant décisif », théorisé par Henri Cartier-Bresson, et l’adage de Robert Capa suivant lequel « si votre photo n’est pas bonne, c’est que vous n’étiez pas assez près (2) ».
Sans doute ces années fastes ont-elles été magnifiées par contraste avec la misère actuelle du photojournalisme. Il existait en réalité des courants privilégiant la pose sur l’instantané, l’esthétique sur le document, le pathos sur le récit, l’arrangement sur l’histoire, mais ces courants, qui sont aujourd’hui dominants, étaient alors dominés. La plupart des « grandes » photographies d’actualité de cette période sont de purs instantanés, sans concessions ni fioritures, réalisés par des opérateurs exceptionnellement sobres et précis. Prise par Don McCullin en 1969, la photo d’un petit Biafrais albinos, tenant à peine debout sur ses jambes filiformes, une boîte de corned-beef entre ses mains fragiles, dévoila à la conscience du monde l’état de famine auquel était réduit un peuple dont, avant ce reportage, on ignorait jusqu’à l’existence.
Le combattant du Front national de libération (FNL) exécuté d’une balle dans la tempe par le chef de la police de Saïgon, puis, quatre ans plus tard, la petite fille courant nue sur une route après s’être débarrassée de ses vêtements enflammés par le napalm, deux documents publiés en « une » de toute la presse internationale (3), révoltèrent l’opinion contre la guerre du Vietnam. Celui de Larry Burrows, paru en double page dans Life, qui montrait un marine blessé se portant au secours d’un de ses camarades dans les boues d’Extrême-Orient, acheva, ajouté aux revers subis par leur armée, de convaincre les Américains eux-mêmes qu’ils ne pouvaient de cette guerre rien espérer d’autre que des pertes catastrophiques et un enlisement total. Si elles n’ont pas à elles seules changé la face du monde, ces images et leurs soeurs, par la rigueur de leurs constats, entraient du moins en résistance contre l’action des puissants.
(…)
Humanisme contre discernement
Tout est plus confus désormais. L’« éthique » des droits de l’homme, qui s’est substituée à l’analyse politique, ou simplement à l’observation honnête et complète, brouille la vision des opérateurs, leur perception précise des lignes de démarcation entre oppresseurs et opprimés, déjoue leur aptitude à localiser les axes de responsabilités. Ils se disent toujours plus ou moins « de gauche », ainsi que l’attestent régulièrement les enquêtes sociologiques (4), mais sont de gauche comme on l’est de nos jours, c’est-à-dire vaguement du côté des « victimes », sans plus bien savoir qui elles sont ni surtout de qui ou de quoi elles le sont (5).
(…)
Hallucinante est cette scène enregistrée en août 1994 au camp de Kabday (8) où l’on voit pas moins de trois opérateurs tourner autour d’un réfugié rwandais, affamé et probablement malade du choléra, obligé de ramper devant eux jusqu’à ce qu’ils soient satisfaits de leur composition. Même séance de pose, deux mois plus tard en Irak : cette fois, le sujet rampant est un marine, unique exemplaire, lot de consolation prêté par le service de presse de l’armée américaine aux photographes et vidéastes désespérés par l’interdiction qui leur est faite d’accéder au front de la guerre du Golfe (9). Par-delà tout jugement moral, que nous dit ce photoreporter qui, pour viser son sujet, prend appui, apparemment sans s’en rendre compte, sur le corps mort ou mourant d’une petite Rwandaise (10), la disqualifiant en quelque sorte une seconde fois ? Au moins ceci : qu’on peut s’immerger dans une réalité sans pourtant rien voir.
Une altérité assimilable
Sans emprunter nécessairement des formes aussi caricaturales, le casting, le mannequinat plus ou moins délibéré, est devenu la règle du « reportage » visuel contemporain. Les individus n’entrent plus dans le cadre d’une image pour leur singularité, ou simplement parce qu’ils sont là – eux et personne d’autre –, ils sont choisis pour leur représentativité statistique, leur conformité à un modèle d’altérité acceptable – donc assimilable – par les canons de la vision occidentale, publicitaire, du monde : assez « autres » pour être exotiques, suffisamment « mêmes » pour mériter notre intérêt et susciter notre compassion (11). Si bien que le « professionnalisme » dont se prévalent les acteurs de la chaîne graphique (opérateurs, éditeurs, iconographes, maquettistes, directeurs artistiques, rédacteurs en chef) pour décider des images à produire, à diffuser et à publier, consiste plus à déterminer ce qui « passe » dans les journaux imprimés ou télévisés qu’à savoir et comprendre ce qui se passe dans le monde.
L’accord, le consensus sur les standards (de ce qui intéresse, mérite, émeut, etc.) est désormais si large que, d’un même événement, des opérateurs différents peuvent rapporter des images absolument identiques. De la poignée de main échangée entre Itzhak Rabin et M. Yasser Arafat, le 13 septembre 1993 à Washington, il existe plus de deux cents versions photo et vidéo que rien de substantiel ne distingue, tout simplement parce qu’elles furent produites par plus de deux cents photographes et vidéastes qui avaient accepté d’être cantonnés sur un même praticable[1] n’offrant la possibilité que d’un seul cadrage. Certes l’astreinte était imposée par les services spécialisés de la Maison Blanche, pour lesquels la mise en scène n’a plus de secrets, dans le but évident de faire apparaître M. William Clinton – c’est-à-dire l’Amérique – en Christ pacificateur (12). Mais ces services n’ont fait – sur un mode coercitif – qu’intégrer à leur propre culture de la communication des principes d’abord mis librement en oeuvre par les photographes eux-mêmes, quand ils découvrirent les vertus manichéennes de l’allégorie et du symbole.
C’est sans se concerter ni même se rencontrer que Marc Riboud, de l’agence Magnum, et Bernie Boston, du magazine Life, retinrent des manifestations pacifistes devant le Pentagone, en 1967, deux clichés semblables, à de minuscules détails esthétiques près : côté cour, des fusils, côté jardin, des fleurs, l’affaire était dans le sac. C’est sans s’interroger sur la question de la duplication que trois photographes et un vidéaste, réunis par les circonstances –ou par l’esprit de corps –, le 5 juin 1989, dans un bureau surplombant l’avenue qui mène à la place Tiananmen, prirent et mirent en circulation strictement la même image, archiconnue, d’un Chinois barrant la route à une colonne de tanks.
Le cas du vidéaste qui travaillait pour la chaîne de télévision britannique ITN est intéressant, car ici l’affaire n’est pas si simple : la séquence qu’il a tournée dure plusieurs minutes. On y voit l’homme s’interposer tandis que la colonne piaffe, puis grimper sur le char de tête à la recherche d’un moyen d’y pénétrer. Le véhicule, qui a maintenant la voie libre et pourrait donc avancer, reste immobile. L’écoutille de la tourelle s’ouvre, un servant s’en extrait, mais l’homme, qui semble avoir renoncé et rebrousse chemin, lui tourne le dos et ne l’aperçoit pas, ce qui rend la situation comique. Le servant, armé, pourrait l’interpeller. Il s’en abstient. L’homme redescend sur le bitume, un groupe de civils l’emmène au loin. ITN n’a monté et diffusé que les premières secondes de ce plan-séquence, le réduisant à un vidéogramme pratiquement identique à l’image fixe dont ses trois confrères sont en quelque sorte les coauteurs.
Le soldat ne tue plus, il soigne
En écartant des rushes jugés impropres à la consommation comme autant de scories risquant de polluer la limpidité du message, la chaîne a pratiqué le même type d’épuration dont procède le reportage contemporain, qui a atteint son paroxysme au Kosovo, où il fallait établir définitivement que les Serbes étaient bien les seuls méchants. Dans la plupart des cas, il s’agit d’obtenir, en négligeant tout ce qui pourrait compliquer les choses, l’opposition duale la plus nette possible, le symbole pur comme le cristal, dégagé de contingences visqueuses, éclatant telle la fontaine d’eau claire, seule propre à étancher la soif, à établir la lumière, à emporter l’adhésion : d’un côté, les baïonnettes, les fusils, les chars, les vautours, les terroristes, les islamistes ; de l’autre, les torses nus, les fleurs, les regards implorants, les populations démunies, les victimes affolées, les distributions de médicaments et de nourriture. Encore l’uniforme tend-il à disparaître derrière le rideau de la censure, car de nos jours le soldat, humanitaire, chirurgical, ne tue plus : il soigne.
Une armée d’opérateurs travaille quotidiennement à la construction de telles allégories, puisant leur inspiration dans une tradition picturale héritée d’Eugene W. Smith, inventeur du « photographe engagé » (concerned photographer), suivant laquelle toute scène est vouée à devenir tableau, comme sa fresque lyrique sur la pollution du village japonais de Minamata. Pour eux, le monde est un gigantesque workshop, un atelier planétaire propice à l’exercice de leur art, au déploiement de leurs « essais », ces photographic essays chers aux reporters au long cours. Dans cette entreprise où il est plus question de peindre que de dépeindre, l’auteur prime sur le sujet, le style sur l’objet, la composition sur le document. « Dans ces photographies, ce n’est pas tant le monde que l’on apprend à connaître que le style des auteurs qu’on cherche à reconnaître », écrit Gilles Saussier (13).
Une indifférence grandissante
Pléthore de messagers, débauche de signes, profusion d’images, ce nouvel état de l’offre visuelle a plusieurs conséquences fâcheuses. D’abord, l’instauration d’un régime déflationniste, caractéristique de toute économie en surproduction : chaque objet produit, en l’occurrence photographies et reportages visuels, y perd en valeur (ici en utilité, en justesse, en qualité, en impact), y compris – les photographes et les vidéastes le ressentent au premier chef – en valeur marchande. Le consommateur (lecteur, téléspectateur, citoyen) exprime cette perte quand il évoque « tout ce qui se passe », suggérant qu’images et événements se noient dans la masse. Il en éprouve une indifférence grandissante, qui est le contraire du but affiché. Continuer à « vendre » dans ces conditions nécessite la création d’une valeur ajoutée : c’est le rôle du « style » – à l’instar du design quand il habille des mécaniques de qualité médiocre – , la pire des solutions en matière de journalisme si le style s’exerce au détriment d’une information complète et vérifiée.
La deuxième conséquence est un constat : les dizaines de milliers d’images produites chaque jour dans le monde viennent s’ajouter aux dizaines de millions d’images conservées dans les stocks d’archives aux fins de recyclage. L’espoir de réaliser des photos singulières se réduit donc au fil du temps. En recourant à un système fini de modèles narratifs, de compositions, cadrages, procédés et effets, les reportages tendent à se ressembler, à se référer les uns aux autres plus qu’à leur sujet, dans un jeu de miroir iconographique où l’enjeu n’est plus la réalité, le récit de l’histoire ou à tout le moins pour l’histoire, mais le jeu lui-même.
Enfin – c’est le plus grave –, le primat de la forme, du rituel ainsi institué, peut, comme l’écrit Gilles Saussier, « conduire tout droit au révisionnisme et à la falsification de l’histoire (14) ». Saussier raconte comment le photographe David Turnley a remporté le premier prix du World Press, l’une des plus hautes distinctions de la corporation, avec un cliché « montrant un soldat américain pleurant la mort d’un de ses camarades victime d’un friendly fire, c’est-à-dire tué par erreur par son propre camp ». « Grâce à lui, écrit-il, un fait tout à fait marginal avait été transformé en une image symbole, résumant et masquant un conflit qui a surtout coûté la vie à des milliers de pauvres bougres irakiens. »
Lors du dernier conflit afghan, les journalistes n’ont, pas plus qu’en Irak, été en mesure de photographier ou filmer à aucun moment des soldats américains en opération. A défaut d’images de la véritable guerre, lecteurs et téléspectateurs eurent droit des mois durant à une distribution de vraies cartes postales : gracieux ballets de cargos militaro-humanitaires, femmes libérées de leur voile et libres de faire la queue devant la façade bleu roi du World Food Programme (WFP) de l’ONU, parachutages de vivres conditionnés dans de jolis sacs jaunes servant habituellement à l’emballage des mines antipersonnel, « bons » miliciens afghans traversant les dunes au soleil couchant, rasages apaisants de barbes musulmanes, enfin, en juillet 2002, visite amicale du secrétaire adjoint américain à la défense, Paul Wolfowitz, et formation sous la bannière étoilée d’une armée afghane « nationale » (voir les photos). Nul doute que les états-majors achèteront encore, dès la prochaine occasion, des dépliants publicitaires aussi gentiment confectionnés.
Le Monde Diplomatique, janvier 2003
NOTES
(1) Issu
d’une intervention lors d’un colloque organisé à Perpignan en septembre 2002
par le festival Visa pour l’image, cet article se cantonne à son sujet
initial : la dégradation du photojournalisme. Pour autant, l’analyse
concerne aussi bien le reportage d’actualité pratiqué par les télévisions. (2)
Capa s’appliqua si bien ce principe qu’il en est mort : le 25 mai
1954, sur la route de Thaï-Binh (Nord-Vietnam), il sauta sur une mine en
franchissant un fossé. (3) Dus respectivement en 1968 et 1972 à Eddie
Adams et à Nick Ut, tous deux photographes de l’Associated Press et récompensés
par un prix Pulitzer. (4) Sans entrer dans le débat sur ce que recouvre
précisément le terme de « gauche », voir, par exemple, l’enquête
publiée dans Marianne du 23 avril 2001 selon laquelle seuls « 6 %
de journalistes pensent voter à droite ». S’agissant plus
particulièrement de photojournalisme, les fondateurs de Gamma ou de Viva, pour
ne citer que ces deux agences, étaient très engagés auprès des avant-gardes
progressistes des années 1960 et 1970. (5) Sur les ravages modernes de
l’idéologie victimaire et de l’éthique des droits de l’homme, voir Alain
Badiou, L’Ethique. Essai sur la conscience du Mal, Hatier, Paris,
octobre 1993. (6) Parmi lesquels James Nachtwey, qui expose une
sélection de ses photographies à la Bibliothèque nationale de France, 58, rue
de Richelieu, Paris 2e, jusqu’au 1er mars 2003. L’oeuvre de Nachtwey, dont le
mobile explicite est la « compassion », semble combiner la
tradition documentaire et l’esthétique victimaire. (7) Sur
l’« effet charter » et la perversité de la promiscuité entre
photoreporters et action humanitaire, voir, à propos du Rwanda, « Blancs
filment Noirs », Le Monde diplomatique, novembre 1994. (8) Par
S. Peterson (Gamma/Liaison). (9) Photo de Laurent Rebours (AP), publiée
dans Libération, 14 octobre 1994. (10) Cette scène, parce que
après plusieurs autres semblables elle avait provoqué sa colère, a été
photographiée en août 1994 entre Goma et Katalé par Jean-Michel Turpin (Gamma)
et publiée dans Le Monde diplomatique de novembre 1994 en accompagnement
de l’article cité. (11) Ce qu’Alain Badiou exprime ainsi : « En
vérité, ce fameux « autre » n’est présentable que s’il est un bon
autre, c’est-à-dire quoi, sinon le même que nous ? » (op.
cit.). (12) Voir « La poignée de main ou l’actualité
programmée », Libération, 29 octobre 1993. (13) Dans
« Situations du reportage, actualité d’une alternative
documentaire », Communications, n° 71, 2001, l’une des
analyses les plus abouties des dérives du photoreportage, dont l’auteur est
initialement un photographe d’agence. (14) Idem.
[1] Plateforme amovible supportant les caméras ou les photographes sur un plateau de télévision.